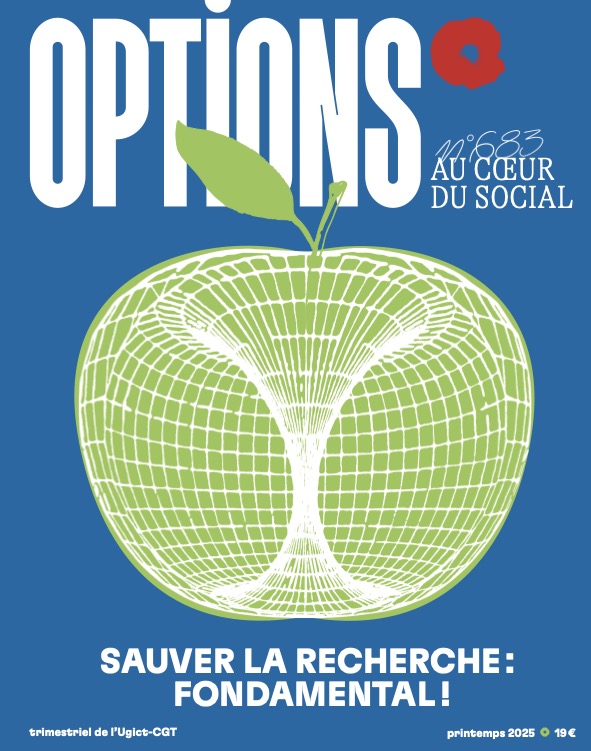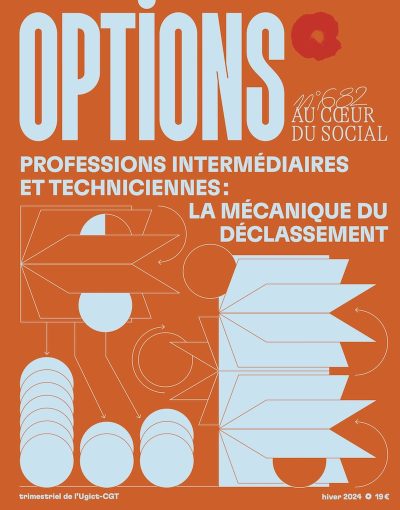C’est à une véritable révélation que l’on peut assister, ces jours-ci, au Musée d’art et d’histoire du judaïsme (Mahj), grâce à un prêt exceptionnel du musée Ryback à Bat Yam (Israël). Il s’agit de dessins et de tableaux de jeunesse d’Issachar Ber Ryback. Né en 1897 à Elisavetgrad (Ukraine actuelle) dans une famille cultivée, il mourra à Paris en 1935. On peut et l’on doit, à juste titre, le définir comme un artiste majeur de la renaissance de l’art juif en Europe orientale.
À l’instar de toute la génération d’artistes de son temps, liée à la littérature et au théâtre yiddish alors en plein essor, Ryback s’attache à une expression plastique spécifiquement juive, en conciliant sa tradition, native, de l’art populaire juif, avec la quête de modernité d’alors, riche des innovations formelles du constructivisme, du cubisme, du cubo-futurisme, de l’expressionnisme, voire du surréalisme.
Dans le but d’affirmer, du monde, une vision juive contemporaine
Il suit d’abord les cours de l’Académie des beaux-arts de Kiev. Il en sort diplômé en 1916. En compagnie de Lazar Lissitzky (1890-1941), qui deviendra un artiste d’avant-garde soviétique reconnu, il se rend dans les villages juifs d’Ukraine, y recopie les peintures des synagogues et les motifs des pierres tombales. Cela lui inspirera l’album de lithographies qui a pour titre Shtetl (« Bourgade »). En 1918, Ryback est partie prenante de la création de la section artistique de la Kultur Lige, organisation juive laïque attentive à la défense et illustration de la culture ancestrale. Un an après, avec Boris Aronson (1899-1980) qui, naturalisé américain, deviendra un décorateur célèbre à Broadway, il signe, sous le titre « Les voies de la peinture juive », un manifeste en faveur d’un art conjuguant les innovations picturales de l’avant-garde européenne et les traditions juives, dans le but d’affirmer, du monde, une vision juive résolument contemporaine.
En décembre 1920, la victoire des bolcheviks à Kiev fait que, pour un temps, le centre de la vie juive se déplace à Moscou. Après un bref séjour en Lituanie, Ryback se rendra en 1921 à Berlin, où il sera considéré comme un franc-tireur cubiste. Rentré à Moscou en 1925, partageant l’enthousiasme révolutionnaire de son ami Lazar Lissitzky, il exécutera des tableaux exaltant la révolution et signera des décors de théâtre. En 1926, il s’installera définitivement à Paris, où il s’éteindra neuf ans plus tard, à la veille d’une grande exposition à lui consacrée. Mauvais sort.
Le grand écrivain et érudit italien Claudio Magris, découvrant à Bucarest, chez un poète yiddish, l’album de gravures et de dessins de Ryback intitulé Shtetl, a pu écrire : « C’est le monde de Chagall, tout aussi magnifique et indélébile, mais en plus fort, en plus poétique. Ryback est un plus grand artiste que le grand Chagall. »

« La grandeur de Ryback resplendit dans l’ombre »
Claudio Magris poursuit en ces termes : « Ryback n’est pas entré dans le courant international comme il le mériterait, et sans doute n’y entrera-t-il plus. Autrefois, le temps et la postérité lui auraient peut-être rendu justice […] mais le temps ne peut plus avoir de ces délicatesses […]. La grandeur de Ryback resplendit dans l’ombre. » Par bonheur, pour un temps, justice lui est rendue au Mahj !
Stéphane Harcourt
Jusqu’au 31 décembre, au Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 71, rue du Temple, Paris 3e.