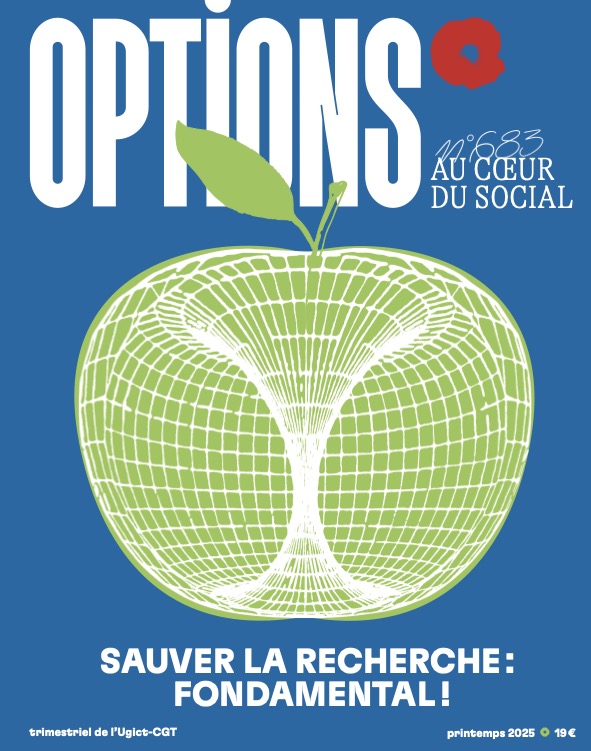La salle 1 est placée sous le signe « Des vices ». On sait que Molière, observateur extra-lucide de la société de son temps, brossa souvent des portraits de personnages qui, pour n’en être pas moins humains, peuvent prêter le flanc au ridicule ou au mépris. L’hypocrisie, au sein de la noblesse du XVIIème siècle, arrive en tête. Dans le Misanthrope, par exemple, nombre de personnages en font preuve. Alceste, lui, qui fait profession de parler franc, est dit, en sous-titre, atrabilaire, c’est-à-dire irritable et coléreux. Géronte, dans les Fourberies de Scapin et Harpagon dans l’Avare, vieillards autoritaires, teigneux, râleurs, mesquins, tyrans domestiques, ont droit le plus souvent à des habits râpés…
Dans la salle 2, c’est « Religion et Libertinage ». La religion, la grande affaire, sous Louis XIV. Sur le trône depuis 1661, soucieux de maintenir la prééminence de la confession catholique, il lutte contre les Jansénistes. C’est dans ce contexte que Molière, au printemps 1664, écrit, en trois actes, le Tartuffe ou l’Hypocrite, que le roi interdira pour des raisons d’ordre religieux. La version que nous connaissons de nos jours, le Tartuffe ou l’Imposteur, sera jouée le 5 février 1669 devant une salle comble.
Le roi n’accepta-t-il pas d’être le parrain de son premier fils ?
Devant Dom Juan ou le Festin de pierre (1665), où un « grand seigneur méchant homme » fait profession d’impiété, une partie de l’Eglise s’insurgea. Il semble néanmoins que Molière était croyant. Le roi n’accepta-t-il pas d’être le parrain de son premier fils ? Au nombre des costumes de ce chapitre, celui de Christian Bérard, en 1947, pour Dom-Juan-Louis Jouvet et celui que Christian Lacroix a conçu, en 2017, pour Tartuffe-Michel Fau.
La salle 3 est dévolue aux « Servantes et Valets ». Ils sont légion dans les pièces de Molière. Ils ont nom Sganarelle, Scapin, Mascarille, Lisette, Toinette… Au Festival d’Avignon 1990, Daniel Auteuil, mis en scène par Jean-Pierre Vincent, fut un Scapin insolent en diable, dans un costume de reître allemand de la Renaissance.

Des unions entre nobles fauchés et bourgeois pleins aux as
En salle 4, on découvre « Bourgeois et Ridicules ». Après les troubles de la Fronde (1648-1651), la monarchie, s’efforçant de réduire le pouvoir de la noblesse et de remplir les caisses de l’Etat, se met à céder charges et offices à des roturiers enrichis dans le commerce. S’ensuivent des unions entre nobles fauchés et bourgeois pleins aux as, d’où, chez Molière, de saisissantes scènes de mœurs opposant des caractères sociaux volontiers incompatibles. Le Bourgeois gentilhomme, Monsieur de Pourceaugnac ou Georges Dandin, entre autres, témoignent de ces heurts de classes. Quant aux ridicules, ils abondent chez Molière. Les auteurs de costumes peuvent s’en donner à cœur joie dans l’excentricité vestimentaire.
La visite se poursuit en huit salles thématiques riches d’enseignements spécifiques (« Pères et Filles », « Malades et Médecins », « Amoureux », « Jaloux et Infidèles », « Précieuses et Savantes », « De l’Antiquité », « Molière en scène » et « La Comédie-ballet »). Ainsi est concrètement exploré, avec un grand luxe déployé au fil des années par tant de talents divers, l’univers de Molière au génie stimulant. La Comédie-Française, dite « la Maison de Molière », est évidemment partie prenante de l’exposition.
Jean-Pierre Lénardini