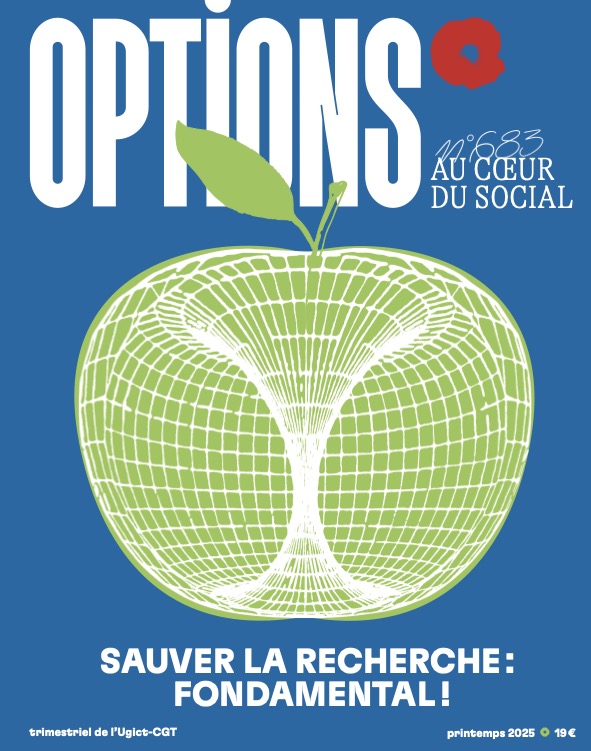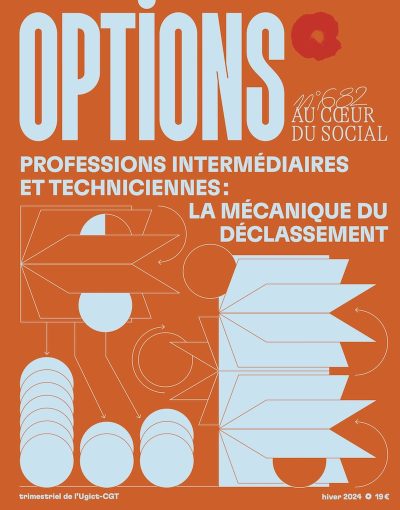À chaque date, une multinationale ou un épisode historique : « 1867 : la révolution bancaire des frères Pereire », « 1927 : les entreprises pétrolières se partagent l’Irak puis le monde », « 1954 : les “républiques bananières” au service de United Fruit », « 1991 : Gazprom, naissance d’un Moloch gazier »… C’est la construction originale, implacable et éloquente de Multinationales. Une histoire du monde contemporain (La Découverte, février 2025). En répondant à nos questions, son codirecteur éclaire les dynamiques à l’œuvre et les pistes de réflexion pour un contre-pouvoir efficace.
Options : Cette histoire des multinationales a été rédigée par un collectif d’historiens et de journalistes. Quelle a été la genèse de ce projet et qu’est-ce qui a guidé votre travail avec Olivier Petitjean ?
Ivan du Roy : L’inspiration vient de L’Histoire mondiale de la France, le livre coordonné par Patrick Boucheron. Nous avons choisi des dates, puis les multinationales qui ont joué le rôle le plus marquant. Cela a permis de raconter à la fois la « grande histoire » et l’histoire spécifique des multinationales, afin d’obtenir un récit incarné, qui rende l’ouvrage accessible. Nous voulions éviter un livre trop académique ou un catalogue, qu’aurait été un simple livre noir de leurs méfaits.
« Plus on se rapproche de notre époque, plus leurs conséquences néfastes – pollutions environnementales, conditions de travail – sont mises en exergue… »
Options : Le ton de l’ouvrage est souvent analytique, sans tomber dans le réquisitoire. Comment avez-vous géré cette posture et quel était votre objectif en adoptant cette distance critique ?
Ivan du Roy : La démarche engagée initialement, c’était de raconter l’histoire des multinationales. Elle est assez peu traitée, hormis dans la presse économique, via l’actualité financière et boursière… voire épisodiquement via l’actualité sociale. Finalement, on aborde peu la question des multinationales ; l’idée était de déconstruire certains fantasmes autour de tel ou tel groupe ou secteur. Et d’avoir une démarche engagée, mais honnête. Dire que, si elles en sont arrivées là, si elles se sont développées, si elles ont accumulé la puissance qu’elles ont aujourd’hui, c’est qu’à un moment, elles ont servi à quelque chose, ont répondu à des besoins, ont eu, ou continuent d’avoir, une utilité, quels que soient les abus qu’elles ont commis. Nous nous sommes astreints à un regard distancié, clinique, sur ce qui s’est passé au XIXe siècle ou dans toute une partie du XXe siècle. Plus on se rapproche de notre époque, plus leurs conséquences néfastes – pollutions environnementales, conditions de travail – sont mises en exergue… le tout en lien avec les critiques sur l’organisation économique contemporaine, la sous-traitance en cascade, l’optimisation fiscale, le fait de ne pas se préoccuper des droits humains.
Options : Face à la puissance de ces acteurs globalisés, quel contre-pouvoir peuvent exercer les organisations syndicales et la société civile ?
Ivan du Roy : Après l’effondrement du Rana Plaza, qui a fait 127 morts et un millier de blessés au Bangladesh en 2013, une loi limitée, mais intéressante, a été introduite en 2017 sur le devoir de vigilance des multinationales vis-à-vis de leurs sous-traitants (un devoir mis aujourd’hui en danger au niveau de l’UE, NDLR). Cette loi est directement issue de la collaboration entre Ong et syndicats européens et asiatiques, réunis au sein du collectif Éthique sur l’étiquette. Quand les syndicats s’extraient de la seule activité au sein de l’entreprise, ils peuvent être cette courroie de transmission entre travailleurs et usagers, consommateurs ou riverains touchés par les impacts environnementaux. Réfléchir ensemble à comment, sans menacer les emplois, on transforme la production, cela s’est fait avec le textile, et cela se fait de plus en plus sur les questions environnementales. La Cgt peut par exemple discuter avec des associations comme Greenpeace, ce n’était pas le cas il y a vingt ans. Les travailleurs acceptent de moins en moins de contribuer à des activités polluantes.
Options : La notion de « compromis » revient souvent dans vos propos. Comment l’envisagez-vous dans la régulation des multinationales, face à des enjeux aussi cruciaux que le climat ou les droits sociaux ?
Ivan du Roy : Tout dépend du rapport de force. Compromis ne veut pas dire compromission. On peut très bien entendre que, pour un dirigeant de groupe, l’organisation du travail doit être efficace et productive, qu’elle génère un minimum de valeur. Après, dans quel cadre et dans quelle proportion, et pour quoi faire ? On peut en discuter. Le compromis est souvent vu comme assez inacceptable. Parce qu’il va nuire à la compétitivité, à la production de richesses, ou a contrario parce qu’il ne va pas assez loin pour les travailleurs, pour l’environnement… Il peut être l’aboutissement d’un rapport de force mais aussi d’une bataille culturelle qui a convaincu des acteurs initialement hostiles à trouver un terrain d’entente. Le compromis est plus durable que la contrainte. Si, sur un sujet donné, on l’obtient entre ne serait-ce qu’une partie des acteurs des multinationales, de la société civile, des syndicats, des politiques, alors on peut embarquer une partie de l’opinion.
Options : Avec l’ouverture du second mandat de Trump, quels chapitres auriez-vous aimé écrire qui ne figurent pas dans le livre ?
Ivan du Roy : Aux États-Unis, l’administration démocrate commençait à songer sérieusement à de nouvelles lois antitrust, comme celles des années 1930, pour limiter le pouvoir des géants de la tech. Le groupe Meta, par exemple, possède Facebook, WhatsApp, Instagram… Google gère et analyse à la fois les mails, un moteur de recherche, YouTube, etc. Le premier résultat de l’alliance entre les Gafam et l’administration Trump, c’est qu’ils vont conserver ce pouvoir exceptionnel, inédit dans l’histoire des multinationales. Les grands trusts des XIXe et XXe siècles, comme Rockefeller ou Morgan, ont parfois acheté des journaux pour gagner en influence. Mais le pouvoir des actuels géants de la tech est beaucoup plus grand, comme le montrent les travaux de Thomas Piketty. Parce qu’ils exploitent des données, et singulièrement des données personnelles, et ont la capacité d’analyser, voire d’influencer les comportements via les réseaux sociaux ou les grandes plateformes de recommandations de type Google News. Initialement, ils le font dans une visée marketing. Mais ils peuvent aussi se découvrir des ambitions politiques, avec des manipulations qui ont déjà existé et peuvent se massifier davantage demain. On ne parle pas ici d’une lutte d’influence entre plusieurs dizaines de grandes fortunes. Il s’agit d’une poignée d’individus, dans une concentration de pouvoir inédite. Même si, jadis, tel ou tel milliardaire pouvait posséder un ou deux quotidiens nationaux pour peser sur le débat public, il existait d’autres supports avec des points de vue différents. Cette pluralité n’existe plus.
Sur les réseaux sociaux, les recommandations poussent au « scroll » et donc à l’addiction, pour mieux placer de la pub. Cela formate et standardise les informations, et crée des bulles informationnelles puisque l’algorithme ne recommande que des choses qui plaisent à l’utilisateur. Sauf si l’algorithme a été conçu dans un but idéologique, et vous recommande régulièrement des contenus d’extrême droite – y compris si vous ne vous êtes jamais abonné à un compte d’extrême droite ! – comme sur le réseau X, d’Elon Musk. Tout cela pose un vrai problème démocratique, de pluralité de l’information, de culture de la nuance, et pourrait, avec le recul nécessaire, justifier de nouveaux chapitres dans le livre.
Propos recueillis par Lennie Nicollet
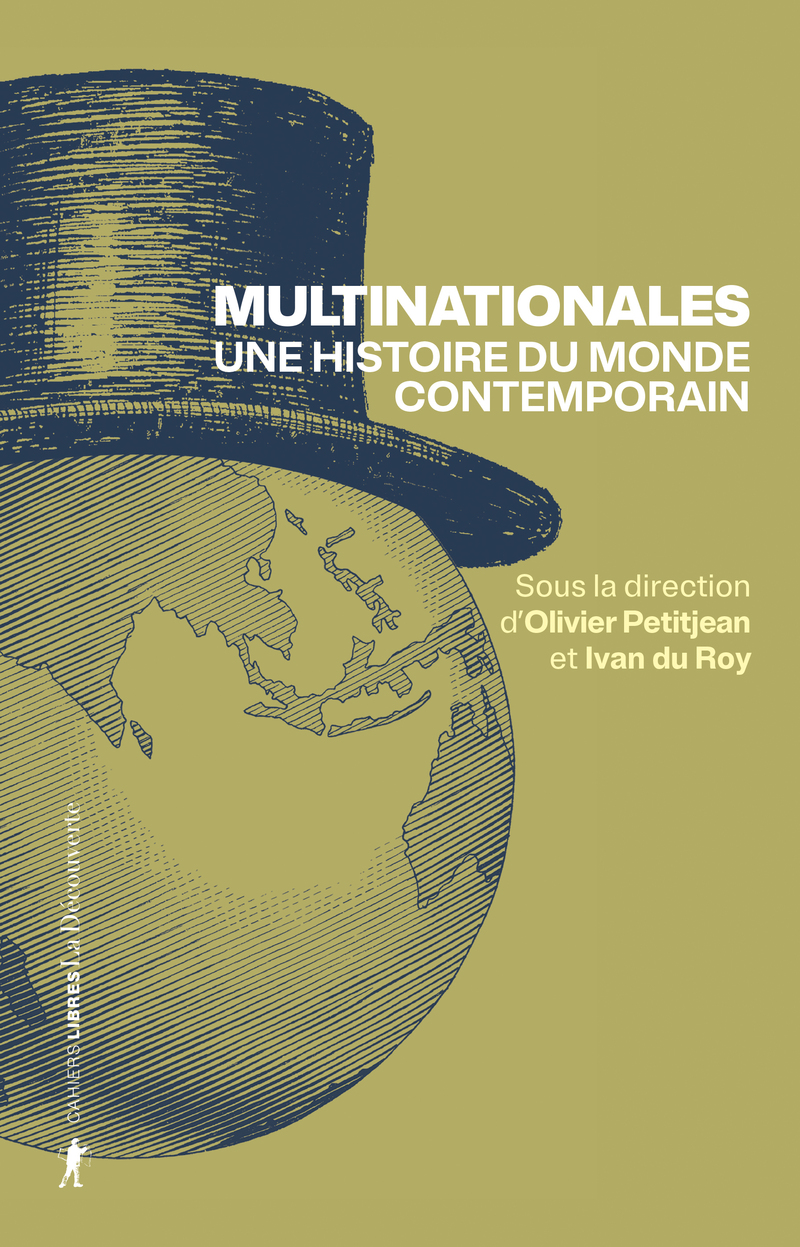
- Olivier Petitjean et Ivan du Roy (dir.) Multinationales. Une histoire du monde contemporain, La Découverte, 2025, 864 pages, 28 euros.