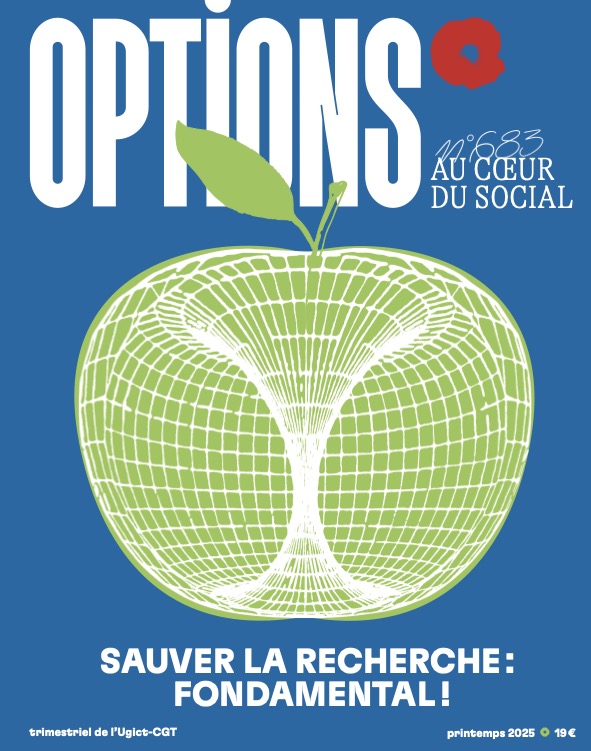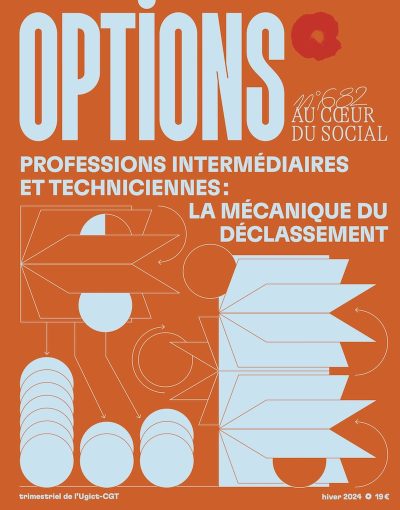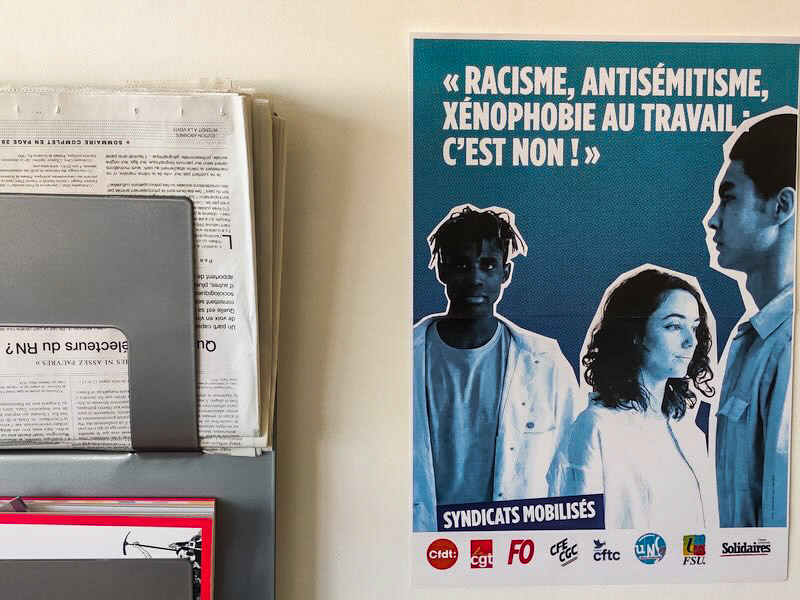Difficile de croire à quel point les choses ont changé au cours de cette année, mais la solidarité et la force de notre mouvement demeurent constantes. À Bruxelles, ce mois d’avril a encore été chargé, à commencer par les propositions « Omnibus » de simplification de la Commission européenne. Comme nous l’avons mentionné, ces propositions ressemblent à une liste de souhaits des entreprises, imitant le discours politique américain et abandonnant la législation fondée sur des données probantes. « Réduire les formalités administratives » ? Cela signifie exclure 80 % des entreprises du champ d’application de la directive sur le devoir de vigilance. « Simplifier les règles » est synonyme de réduction des normes législatives.
Les enjeux portent principalement sur deux directives, celle concernant la durabilité et le devoir de vigilance des entreprises (CSDD) et celle sur le reporting des entreprises (CSRD), avec la volonté de chercher à diluer de nombreuses victoires durement gagnées. Parmi elles : la suppression de l’obligation de mettre en œuvre des plans de transition climatique ; l’ouverture de la porte au greenwashing des entreprises ; la réduction drastique de la portée tout au long des chaînes d’approvisionnement ; enfin la suppression de la surveillance en temps réel.
Lors de la plénière de Strasbourg, les députés européens ont en outre voté un report d’un an pour la CSDD, de deux ans pour la CSRD. Certes, cela signifie que même une législation très assouplie n’aura pas d’impact avant un an ou deux. Mais il s’agit du moindre mal.
Un plan d’action pour l’intelligence artificielle
En ce qui concerne les besoins réels des travailleurs, nous avons également discuté de la feuille de route pour des emplois de qualité avec la commissaire Roxana Mînzatu. Aux côtés d’autres partenaires sociaux, les syndicats ont souligné la nécessité d’une législation portant notamment sur les risques psychosociaux, le management algorithmique, le télétravail et le droit à la déconnexion. Cette feuille de route, dont la publication est prévue au quatrième trimestre 2025, reste malheureusement un concept vague, sans aperçu de son contenu.
La Commission est prête à progresser dans le domaine de l’IA, avec un Plan d’action dévoilé ce mois-ci. Promettant des investissements pouvant atteindre 200 milliards d’euros, la création de cinq giga-usines et de treize usines d’IA dans l’Union européenne, cette initiative fait suite à un important travail législatif dans ce domaine. Elle sera suivie d’autres propositions sur l’IA dans les prochains mois. Sachant qu’il s’agit d’exploiter l’utilisation de ces technologies dans des domaines spécifiques, tels que le secteur public et la santé, nous saluons l’un des principes fondamentaux de la Commission, à savoir l’utilisation de modèles fiables et centrés sur l’humain. Nous notons toutefois le manque de précisions sur plusieurs points clés.
Centres de données : un impact environnemental négligé
Le premier mandat de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, était axé sur l’introduction du Pacte vert pour l’Europe. Ce dernier a, depuis, été considérablement revu à la baisse avec le nouveau programme de simplification. Il fait l’objet d’attaques constantes de la part de l’extrême droite et du Parti populaire européen. Conformément au nouveau mantra de la compétitivité avant tout, l’impact environnemental du triplement de la capacité des centres de données européens d’ici 2035 est clairement négligé. Une seule référence à la nécessité de la durabilité est mentionnée. Aucune voix claire ne se fait entendre pour concrétiser les ambitions d’une réduction des émissions de carbone : est ainsi prévu que « les projets de centres de données qui répondent aux exigences en matière d’efficacité des ressources, notamment en matière d’efficacité énergétique et hydrique, de circularité et d’innovation, bénéficieront d’une procédure d’autorisation simplifiée, tout en maintenant les garanties environnementales et en protégeant la santé humaine. »
Comme l’a souligné Eurocadres l’année dernière, l’utilisation et le développement des systèmes d’IA ne devraient pas être exemptés d’objectifs de durabilité ni de sanctions potentielles. Un rapport de 2024 cite des estimations de l’Agence internationale de l’énergie selon lesquelles, à l’échelle de l’industrie, la consommation énergétique des centres de données alimentant l’IA doublera au cours des deux prochaines années, consommant autant d’énergie que le Japon. Ces centres de données et systèmes d’IA consomment également de grandes quantités d’eau pour leurs opérations et sont souvent situés dans des zones déjà confrontées à des pénuries d’eau.
Vers un projet « Omnibus » sur l’IA
La transparence, la sécurité des travailleurs et la protection contre les risques, ainsi que la responsabilisation en cas de lacunes constatées, doivent être des éléments centraux du développement futur de l’IA dans une Europe déjà en pleine mutation. Or, ces éléments sont absents du plan proposé. Un projet de loi « Omnibus » sur la règlementation existante de l’intelligence artificielle a également été annoncé pour la fin de l’année, soulignant une fois de plus l’intention de réduire les protections législatives.
La nécessité de se former pour saisir les opportunités offertes par l’IA est heureusement soulignée. Mais, une fois de plus, nous répétons que, sans un droit contraignant à la formation, pendant les heures de travail et gratuitement pour les travailleurs, les déficits de compétences dénoncés par les employeurs continueront de se creuser.
Les entreprises ont de quoi se réjouir, en témoigne l’utilisation de fonds totalisant environ 200 milliards d’euros dans le plan, sans référence à des emplois de qualité, à des marchés publics équitables et efficaces, assortis de critères clairs pour éviter la mauvaise allocation des fonds publics aux entreprises qui contournent les règles européennes aux préoccupations environnementales. Ce mouvement illustre une fois de plus la direction que prend cette Commission.